Par Mamadou Ismaïla KONATÉ
Avocat à la Cour, Barreaux du Mali et de Paris
Ancien garde des Sceaux
Introduction
Le décret n°2025-0318/PT-RM du 7 mai 2025, adopté en Conseil des ministres, suspendant les activités des partis politiques au Mali, s’inscrit dans la lignée des mesures autoritaires prises sous la Transition. Il traduit, sous couvert de l’ordre public, une volonté manifeste de museler la vie politique et d’éteindre le pluralisme constitutionnellement garanti.
Or, le respect des libertés publiques, notamment de la liberté d’association et du pluralisme politique, constitue un pilier de l’État de droit. Toute restriction à ces libertés doit satisfaire à des conditions strictes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, telles que reconnues par le droit constitutionnel, le droit pénal malien et le droit international.
L’analyse du décret révèle à la fois son absence de base légale sérieuse, son caractère manifestement arbitraire, et l’instrumentalisation abusive de l’ordre public comme justification.
I. Un décret dépourvu de fondement juridique et caractérisé par son illégalité manifeste
A. Une carence de base légale au regard des normes constitutionnelles et législatives
Le décret se prévaut de divers fondements généraux (Constitution, Charte de la Transition, lois relatives aux associations et à la liberté de réunion) mais aucun texte n’habilite expressément l’exécutif à suspendre globalement l’activité des partis politiques.
Or, selon le principe fondamental de légalité :
- Toute restriction aux libertés fondamentales doit être prévue par une loi formelle (CE, Amar, 1936 — principe repris par la CCJA, Aff. Bolloré / Douala Port, 2017) ;
- Elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée (CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, 1976 ; CC Mali, Décision n°2020-04/CC du 4 août 2020 sur la loi électorale).
Les textes maliens eux-mêmes sont clairs :
- La Constitution (art. 39 et 185) garantit expressément le pluralisme politique et l’existence des partis ;
- La Loi sur les associations limite la suspension ou dissolution à des mesures individuelles, motivées et prononcées judiciairement ;
- La loi sur la liberté de réunion (ancien régime juridique) prévoit uniquement des interdictions ponctuelles et ciblées en cas de trouble imminent.
En conséquence, la suspension générale et globale ordonnée par simple décret excède manifestement les pouvoirs de l’exécutif, violant le principe de légalité.
B. Une mesure arbitraire et disproportionnée contraire aux exigences constitutionnelles et pénales
Au-delà de l’absence de fondement juridique, la mesure ainsi prise par le gouvernement de transition militaire :
- Est générale et indéterminée dans le temps, ce qui heurte directement le principe de proportionnalité ;
- N’est justifiée par aucun trouble grave ou imminent, selon les propres termes du décret ;
- Assimile toutes les formations politiques sans distinction, annihilant ainsi le pluralisme.
Cette situation place le décret dans la sphère de l’illicite pénal :
- Attentat à la Constitution (Articles 241-1 et suivants) :
Constitue un attentat à la Constitution « tout comportement violant la Constitution et ses principes » (article 241-1). La violation du pluralisme politique garanti par la Constitution entre indubitablement dans cette catégorie.
- Atteinte illégale aux libertés publiques (Article 241-3) :
L’acte d’interdiction générale et absolue, sans base légale, constitue un acte arbitraire attentatoire aux droits civiques, réprimé expressément par cet article.
- Abus d’autorité : Même en l’absence d’un article formel sur l’abus d’autorité, le comportement du gouvernement peut relever de l’exercice illégal ou excessif du pouvoir public portant atteinte aux droits garantis par la Constitution.
Ces approches ont été validées par la jurisprudence (Cour suprême du Mali (Ch. Crim., arrêt n°123 du 11 juin 2019) ; Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Affaire Lohe Issa Konaté c/ Burkina Faso, 2014).
II. L’ordre public, un alibi juridiquement fallacieux et inopérant
A. L’ordre public ne peut fonder des atteintes générales et absolues aux libertés
L’ordre public peut justifier des restrictions, mais sous conditions strictes :
- Elles doivent être nécessaires et proportionnées ;
- Elles doivent être limitées dans le temps et ciblées.
La jurisprudence (Kessler c/ France (CEDH, 2023) ; la Cour suprême du Sénégal (Arrêt n°78 du 25 octobre 2018) condamne les interdictions générales infondées.
En l’espèce, aucun trouble grave ou imminent n’est démontré. L’ordre public est invoqué comme un prétexte pour museler l’opposition.
B. L’instrumentalisation de l’ordre public : une dérive autoritaire et anticonstitutionnelle
Le véritable objectif du décret :
- Empêcher toute contestation politique ;
- Neutraliser les adversaires du régime ;
- Installer un régime de fait à parti unique ou sans partis, contraire aux engagements internationaux du Mali (art. 13 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance).
Cette dérive viole autoritaire :
- La Constitution malienne qui garantit le pluralisme ;
- Les engagements régionaux et internationaux du Mali ;
- Les principes généraux de l’État de droit.
La jurisprudence africaine condamne fermement ces pratiques. La Cour constitutionnelle du Bénin (Décision DCC 17-262 du 5 décembre 2017) a rappelé que “la préservation de l’ordre public ne saurait justifier la suppression des libertés politiques”.
Conclusion
Le décret n°2025-0318/PT-RM est :
→ Illégal, en raison de l’absence de fondement normatif habilitant l’exécutif à suspendre globalement les partis politiques ;
→ Arbitraire et disproportionné, dès lors que la mesure est générale, absolue et non justifiée ;
→ Pénalement répréhensible, au titre de l’abus d’autorité, de l’atteinte illégale aux libertés publiques et de l’atteinte à la Constitution ;
→ Anticonstitutionnel et antidémocratique, en ce qu’il vise à priver le peuple malien du droit fondamental au pluralisme politique.
L’ordre public est un alibi pour une confiscation autoritaire du pouvoir. Cette dérive menace l’État de droit au Mali
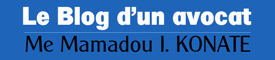
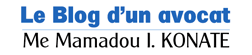
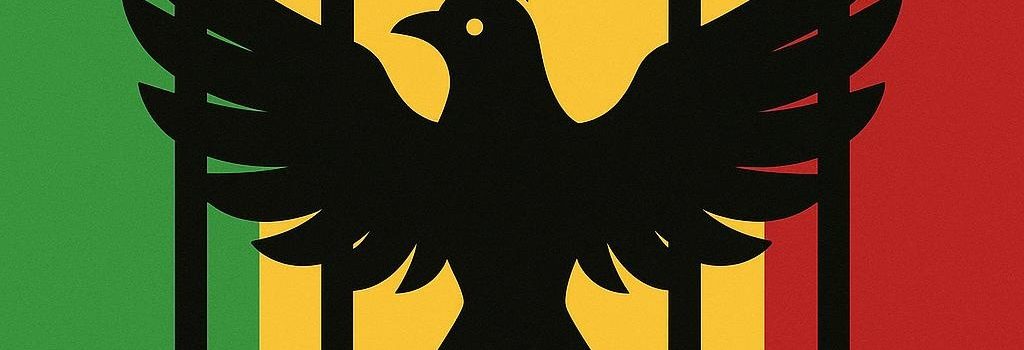







Faire un commentaire