Par Mamadou Ismaïla KONATÉ
Avocat à la Cour, Barreaux du Mali et de Paris
Arbitre, ancien Garde des Sceaux
Introduction générale
Peut-on parler de démocratie sans partis politiques ? À cette question simple, la réponse est sans détour : non. Même imparfaits, critiqués, parfois instrumentalisés, les partis politiques sont les véritables artisans du pluralisme et de l’expression populaire. Lorsqu’un régime décide de les suspendre ou de les réduire au silence, c’est toute la démocratie qui s’éteint progressivement, laissant place à l’unanimisme, à la peur et à l’autoritarisme.
Dans l’espace africain, les partis ont été souvent malmenés. Et pourtant, dans plusieurs pays, ils ont permis l’alternance, le progrès des libertés et la participation citoyenne. Il faut donc en comprendre le rôle, rappeler leur ancrage dans le droit, et identifier les conditions d’un pluralisme politique sain.
I. Les partis politiques en Afrique – une fonction démocratique irremplaçable
1. Une histoire enracinée dans la lutte pour la liberté
Les partis politiques africains sont nés dans le contexte des luttes pour l’indépendance. Ils ont incarné la volonté d’émancipation des peuples et ont permis de porter un projet national collectif. Le Rassemblement Démocratique Africain (RDA), le PDG de Guinée, ou encore l’ANC en Afrique du Sud ont été bien plus que des appareils électoraux : ce furent des instruments de mobilisation et de structuration politique du peuple.
2. Des acteurs essentiels du suffrage universel
Dans une démocratie, le suffrage universel (le droit de vote pour tous les citoyens majeurs) est l’expression la plus visible de la souveraineté populaire. Mais voter suppose choisir entre plusieurs visions, projets ou équipes. Ce sont les partis politiques qui organisent cette offre, qui proposent des candidats, et qui animent le débat public.
3. Des exemples concrets de contributions démocratiques
Malgré des critiques légitimes sur leur fonctionnement, les partis politiques africains ont parfois permis des transitions pacifiques et ouvert la voie à des progrès démocratiques. Exemples :
– Au Sénégal, les alternances entre le Parti Socialiste, le PDS et l’APR ont permis de maintenir un pluralisme électoral.
– Au Cap-Vert, le PAICV et le MpD se sont succédé pacifiquement, garantissant la stabilité politique.
– En Afrique du Sud, l’ANC a été confronté à une opposition parlementaire active, même au sommet de son hégémonie.
– Au Ghana, les alternances entre le NPP et le NDC ont renforcé la crédibilité démocratique du pays.
II. Garantir le pluralisme, défendre les partis : une responsabilité démocratique
1. La suspension des partis : un danger pour la démocratie
Quand un régime suspend les activités des partis politiques, même temporairement, il bloque le jeu démocratique. Il empêche les citoyens d’avoir un choix, confisque la parole politique, et affaiblit les libertés publiques. C’est ce qui s’est produit récemment au Mali.
2. Ce n’est pas à l’État de “corriger” les partis
Les critiques envers les partis sont fondées. Mais ce n’est pas à l’exécutif, encore moins à un régime militaire, de juger de leur utilité ou de les interdire. Le droit doit encadrer les partis — pas les détruire. La réforme doit venir de l’intérieur.
3. Quand il n’y a plus de partis, il n’y a plus de pluralisme
Un pays sans partis, c’est un pays sans opposition institutionnelle, sans débat public structuré, et où le pouvoir n’a plus de compte à rendre. La suppression des partis est souvent le prélude à la dictature.
Conclusion
Le débat sur les partis politiques en Afrique ne doit pas être tranché par des décrets ni des armes. Il doit être porté par le droit, nourri par le peuple, et encadré par des institutions solides. Critiquons les partis, oui. Réformons-les, absolument. Mais supprimons-les, jamais. Car sans partis politiques libres et légitimes, il n’y a ni suffrage véritable, ni pluralisme, ni démocratie.
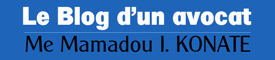
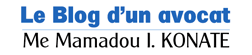









Faire un commentaire